«Un jour, il n’y aura plus d'infarctus du myocarde»
La recherche est toujours pleine d’incertitudes, dit le professeur Thomas F. Lüscher, président de la Commission Recherche de la Fondation Suisse de Cardiologie. Mais sans la recherche, les énormes progrès de la cardiologie n’auraient pas été possibles. Dans l’interview, il explique dans quelles directions il place ses espoirs.
Pourquoi devient-on cardiologue?
Pr Thomas F. Lüscher: C’est différent pour chacun. Au départ, je voulais devenir psychiatre ou neurologue. Lorsque mon père a été victime de la mort subite cardiaque, je me suis demandé comment on pouvait mourir aussi soudainement. Je me suis de plus en plus intéressé au coeur et à la circulation sanguine.

Et comment devient-on effectivement cardiologue?
Après les études de médecine, il faut passer deux ans en médecine interne en tant que médecin assistant, c’està- dire qu’on découvre un peu tout. Ensuite, on suit une formation postgraduée de quatre ans en cardiologie pour devenir spécialiste en cardiologie, mais on ne maîtrise alors pas encore les interventions spécialisées. Le cathétérisme ou l’imagerie, par exemple, requièrent encore des années de formation.
De quoi a-t-on besoin pour être un bon cardiologue?
D’abord, il est utile d’être intelligent. Ensuite, cela dépend de ce qu’on fait exactement. Un exemple: ceux qui s’occupent d’imagerie et de diagnostics ont plutôt une personnalité réfléchie et visuelle. Par contre, pour manier le cathéter cardiaque, il faut avoir un côté cow-boy, être sûr de soi et un peu téméraire. On soigne au milieu de la nuit un patient victime d’un infarctus du myocarde, il peut mourir d’un instant à l’autre. Tout le monde n’est pas fait pour le supporter. En cardiologie, nous avons donc besoin de différentes compétences pour différentes tâches.
Un hôpital universitaire ne soigne pas seulement les patients, une chaire de professeur inclut aussi la recherche et l’enseignement. Que préférez-vous?
J’aime le mélange. La cardiologie est l’une des rares disciplines dans lesquelles on peut à la fois faire de la recherche et soigner. J’ai beaucoup travaillé avec le cathéter cardiaque tout en faisant de la recherche fondamentale.
Vous avez donc suivi les récents progrès de la cardiologie de très près.
Lorsque le président américain Eisenhower fut victime d’un infarctus du myocarde le 23 septembre 1955, les médecins ne purent rien faire. Ils durent même aller chercher un électrocardiographe dans un hôpital éloigné. Le taux de décès, pour autant que les personnes atteignent l’hôpital, était d’environ 50%. Aujourd’hui, il se situe entre 5 et 10%. Une victime d’infarctus est aujourd’hui transportée en ambulance au centre de cardiologie le plus proche et passe immédiatement au laboratoire de cathétérisme cardiaque. Nous introduisons le cathéter et libérons le vaisseau, ce qui remédie au problème immédiat. Cette évolution extraordinaire est due au fait que la cardiologie était et est toujours une discipline orientée vers la recherche. Il y a peu d’autres domaines où autant de grandes études randomisées et une recherche fondamentale d’une telle ampleur sont effectuées.
En dépit des succès considérables, de plus en plus de personnes remettent en doute ce que disent les scientifiques. Qu’en pensez-vous?
La recherche de la vérité occupe l’humanité, et plus particulièrement les philosophes, depuis toujours. La différence entre la religion ou l’idéologie et la science est qu’en tant que scientifiques, nous devons en permanence remettre notre opinion en question. Nous faisons des expériences et nous mesurons si une affirmation est correcte ou non. Et si les études ne confirment pas ce que je pensais au départ, je suis bien obligé de rectifier mon opinion, que cela me plaise ou non. Cela m’est déjà arrivé un certain nombre de fois. La science est une manière de traiter les faits et les chiffres qui peut sembler froide et difficile. Ce ne sont pas des histoires extraordinaires que l’on peut se raconter autour d’un feu de camp.
Vous avez écrit que la recherche est toujours pleine d’incertitudes. Que vouliez-vous dire par là?
Premièrement, la plupart de nos hypothèses sont finalement fausses. Comme l’a dit le Prix Nobel suisse Rolf Zinkernagel, il faut beaucoup de chance en tant que chercheur pour pondre un jour un oeuf d’or. Ensuite, les théories scientifiques ne sont jamais achevées, elles sont provisoires et se modifient en permanence en fonction de la réalité. Troisièmement, les postes des chercheuses et chercheurs ne sont pas sûrs. L’argent d’un projet de recherche peut subitement faire défaut.

Quelle importance revêt l’encouragement de la recherche par des organisations non-gouvernementales, comme par exemple la Fondation Suisse de Cardiologie?
Une importance énorme. Les chercheurs qui travaillent en clinique ne reçoivent pratiquement pas d’argent des universités, uniquement des locaux. Pour tout le reste, nous devons trouver des financements externes, c’est-àdire faire appel au Fonds national suisse et à la Fondation Suisse de Cardiologie. Celle-ci joue un rôle capital pour la recherche cardiologique. Mais les fonds actuellement disponibles ne suffisent pas pour être vraiment concurrentiel à l’échelon mondial. Nous avons besoin de plus de personnes qui soutiennent généreusement nos travaux de recherche.
Quels seront les défis à relever en cardiologie dans un avenir proche du fait du vieillissement de la population?
La plupart des maladies de coeur sont liées à l’âge. Nous les contractons parce que l’évolution n’a pas prévu que nous vivions aussi vieux. Prenons par exemple le cholestérol: les animaux ne font pas d’infarctus du myocarde. Mais les êtres humains ont un taux de cholestérol x fois supérieur à celui d’autres mammifères et c’est largement dû à notre mode de vie. Pendant la première moitié de notre vie, cela se fait rarement sentir. Mais avec l’âge, l’infarctus du myocarde en est la conséquence.
Qu’est-ce que cela signifie pour la médecine?
Les processus de vieillissement et d’apparition des maladies sont commandés par la génétique. Toute personne ayant trop de cholestérol n’aura pas d’infarctus du myocarde. Les gènes qui commandent le vieillissement déterminent aussi si nous allons contracter ou non une maladie liée à l’âge. En modifiant ces gènes, nous pourrions nous protéger de certaines maladies, nous serions par exemple résistants à l’hypercholestérolémie ou au diabète. En laboratoire, nous avons pu le démontrer, mais il faut d’autres travaux de recherche avant de passer à une application clinique.
Est-ce une voie envisageable pour de nouvelles méthodes de traitement?
La prochaine grande étape de développement se fera au niveau génétique. Cela va prendre encore des années, mais nous avons déjà fait des progrès notables dans la lutte contre les maladies génétiques. Prenons par exemple les cardiopathies congénitales. Une personne qui semblait en bonne santé est victime de la mort subite cardiaque à 30 ans, en jouant au foot. Aujourd’hui, nous connaissons les gènes qui causent cette maladie et, avec un défibrillateur, nous pouvons éviter le pire. Mais nous ne pouvons pas guérir ces patients. Or il existe un outil appelé CRISPR/Cas9 qui, un peu comme des ciseaux, est capable de découper et remplacer les gènes en question. Tôt ou tard, nous pourrons guérir ces maladies monogéniques, tout au moins chez les patients jeunes.
Et en attendant, quelles sont les alternatives?
Notre grand problème est que nous pouvons soigner les maladies de coeur, mais pas les guérir. Les patients doivent prendre des médicaments toute leur vie. C’est pénible et l’effet n’est pas optimal. Pour reprendre l’exemple du cholestérol, nous cherchons actuellement une substance capable de désactiver de manière ciblée, dans les cellules du foie, le gène d’une protéine qui régule les récepteurs de LDL. Ainsi, le cholestérol LDL baisse fortement pendant six mois. Nous finirons par arriver à désactiver ce gène pendant des années ou définitivement. Il n’y aura alors plus d’infarctus du myocarde. Des herbes médicinales, nous sommes passés aux médicaments qui agissent à la surface des cellules et nous arrivons maintenant à des substances qui interviennent dans le fonctionnement cellulaire. C’est un monde entièrement nouveau.
Notre mode de vie malsain sera-t-il alors un jour sans importance?
Non, notre mode de vie reste extrêmement problématique. Nous bougeons de moins en moins, donc nous dépensons moins de calories. Mais il nous suffit d’aller chez Migros pour acheter autant d’aliments que nous voulons. Et de ce fait, c’est en particulier avec l’âge que nous prenons du poids. Nous parlons d’une épidémie de surpoids, les Suisses grossissent légèrement chaque année. Mais ce n’est pas un problème cardiologique, c’est un problème de société. Si votre cardiologue vous dit d’arrêter de fumer, l’effet est limité. Par contre, ce qui a fait de l’effet, c’était d’augmenter le prix des cigarettes et d’interdire en partie de fumer. Il faut intervenir par la législation, c’est malheureux, mais c’est à mon avis la seule solution.
Article de notre magazine COEUR et ATTAQUE CÉRÉBRALE, août 2019
En savoir plus
L'encouragement de la recherche par la Fondation Suisse de Cardiologie
Comment mieux soigner les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque? Quel est le rapport entre la fibrillation auriculaire et la démence vasculaire? Pourquoi le cœur des femmes bat-il autrement? Pourquoi imprimer le cœur d’un enfant avant d’opérer? La brochure sur la recherche permet de découvrir des aspects actuels de la recherche cardio-vasculaire en Suisse.
Les dons contribuent à mieux comprendre les maladies cardio-vasculaires, les dépister plus tôt et les traiter avec plus d’efficacité. Vous aussi, aidez-nous.
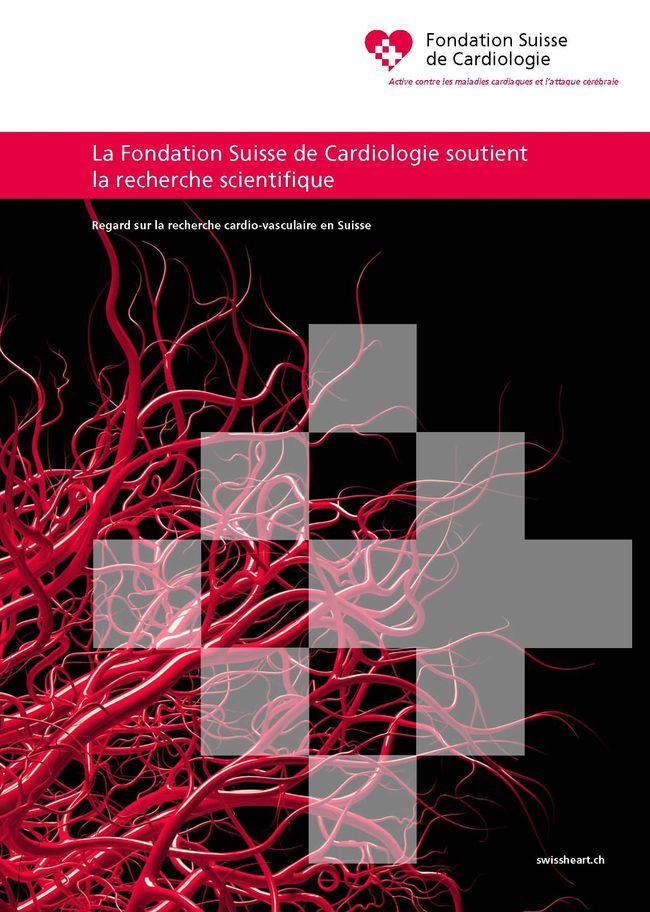
Partager le site Internet