Comment les troubles du rythme cardiaque portent atteinte à notre cerveau?
On sait depuis assez longtemps que la fibrillation auriculaire peut déclencher une attaque cérébrale. Mais il reste de nombreuses questions sans réponses: quand et comment des caillots dangereux se forment-ils? Peuvent-ils aussi porter atteinte au cerveau à l’insu de la personne touchée? Les troubles du rythme cardiaque sont-ils la cause d’une baisse des performances du cerveau, voire d’une démence? Un vaste projet de recherche dirigé par le professeur Michael Kühne se penche sur ces questions.
La fibrillation auriculaire est de plus en plus souvent en point de mire de la recherche en cardiologie. Quelle est la fréquence de la maladie?
Pr Michael Kühne: Elle est tout en haut de la liste des causes envisageables lorsqu’un patient nous consulte pour des symptômes tels que battements de coeur accélérés ou palpitations. La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque durable que nous rencontrons le plus fréquemment en clinique.
Que se passe-t-il dans le coeur en cas de fibrillation auriculaire?
Le noeud sinusal est notre métronome qui stimule régulièrement le rythme cardiaque normal. Mais il peut tomber en panne. Si le rythme cardiaque devient alors complètement désordonné, c’est ce que l’on appelle fibrillation auriculaire. L’atrium proprement dit (l’oreillette) ne bat plus régulièrement avec 50 à 80 battements par minute, mais très irrégulièrement et beaucoup trop vite: 300 à 500 battements par minute. Une allure aussi désordonnée fait que l’atrium ne peut plus se contracter, il est pris de frémissement, c’est ce que l’on appelle la fibrillation. En plus, des stimuli électriques incontrôlés activent le noeud atrio-ventriculaire, dont le rôle est de contrôler la transmission des stimuli aux ventricules. De ce fait, les ventricules battent eux aussi irrégulièrement et en général trop vite. Ces arythmies peuvent se produire par épisodes ou, si la maladie est présente depuis longtemps, durablement.
Comment peut-on remarquer la fibrillation auriculaire, à part par des battements trop rapides ou des palpitations?
Les patients concernés ressentent un pouls irrégulier ou qui s’accélère trop vite lors d’un effort physique. Il se peut aussi qu’ils ressentent désagréablement les battements de leur coeur. D’autres patients se sentent moins performants lors d’un épisode de fibrillation auriculaire ou ont du mal à respirer lorsqu’ils gravissent les escaliers. Mais une partie non négligeable des personnes touchées, environ 30 %, n’ont pas de symptômes et la fibrillation auriculaire est découverte par hasard.

Quelles sont les conséquences de ces activités cardiaques chaotiques?
Un danger immédiat est l’attaque cérébrale. En raison de l’irrégularité des activités de l’atrium, un caillot de sang peut se former, être véhiculé dans la circulation sanguine du cerveau et y causer une obstruction aigüe. 20 % des attaques cérébrales sont dues à la fibrillation auriculaire et ce sont souvent des cas particulièrement graves car les caillots sont relativement gros. Si la fibrillation auriculaire n’est pas soignée pendant longtemps, elle endommage aussi le coeur proprement dit. Du fait de l’irrégularité de la fonction cardiaque, les ventricules pompent de moins en moins bien et cela débouche avec le temps sur l’insuffisance cardiaque. Inversement, une insuffisance cardiaque existante peut causer une fibrillation auriculaire.
Sait-on comment ces caillots de sang se forment?
Après des dizaines d’années de recherche intensive, il reste pas mal de zones d’ombres. L’hypothèse partiellement étayée par des données est qu’une partie de l’atrium appelée auricule, dont la paroi n’est pas lisse mais couverte de renflements, est de ce fait propice à la formation de caillots lorsque l’auricule, en raison des contractions rapides et irrégulières, ne peut plus se vider correctement. Des autopsies de patients décédés d’une attaque cérébrale ont permis de voir que la plupart des caillots se trouvaient dans l’auricule de l’atrium. Lors d’échographies réalisées avant une intervention chirurgicale sur le coeur, c’est aussi là qu’on rencontre le plus de caillots. Mais cela n’explique pas encore quand et à cause de quels facteurs ces caillots se forment.
Visiblement, les caillots ne se détachent pas seulement directement pendant un épisode de fibrillation auriculaire.
Exactement. C’est un aspect important pour nous, sur lequel porte un point fort de notre recherche. Chez les patients atteints de fibrillation auriculaire chez lesquels on surveille durablement les arythmies à l’aide d’un appareil d’enregistrement implanté, on constate que l’attaque cérébrale ne coïncide pas toujours avec un épisode de fibrillation auriculaire. Certains patients n’ont plus de fibrillation auriculaire depuis des mois et subissent tout de même une attaque cérébrale. Une hypothèse est que les caillots se forment pendant la fibrillation auriculaire, mais peuvent en principe se détacher à tout moment. Une autre question est celle de savoir si certaines attaques cérébrales chez des patients atteints de fibrillation auriculaire ont au moins en partie d’autres causes que la fibrillation auriculaire.
Le trouble du rythme cardiaque ne suffit donc pas à lui seul à expliquer la survenue d’une attaque cérébrale?
Non. Les patients atteints de fibrillation auriculaire persistante (durable) sont plus souvent victimes d’attaques cérébrales que les patients atteints de fibrillation auriculaire paroxystique (survenant par crises). On pourrait en déduire que les premiers ont tout simplement leur fibrillation auriculaire pendant plus longtemps et font de ce fait plus souvent une attaque cérébrale. Mais ce n’est pas si simple. Les patients atteints de fibrillation auriculaire persistante sont aussi plus malades, ils ont plus souvent une insuffisance cardiaque, un diabète ou une hypertension artérielle. Il se pourrait donc que ces facteurs supplémentaires soient décisifs pour qu’une personne subisse ou non une attaque cérébrale. C’est ce que nous étudions dans le projet de recherche Swiss AF-Burden.
Comment peut-on évaluer le risque de formation de caillots?
Aujourd’hui, nous travaillons avec ce que l’on appelle des scores. Nous évaluons le risque à l’aide de ce score, par exemple si un patient a en plus de l’hypertension artérielle ou un diabète, et cela nous sert à décider du traitement préventif. La plupart des patients âgés reçoivent un anticoagulant pour empêcher la formation de caillots. Les patients plus jeunes au score peu élevé, dont le risque est donc bas, peuvent éventuellement s’en passer. Mais nous n’avons pas encore de conclusions définitives et on peut encore espérer améliorer les scores pour ce qui est de leur capacité à prédire l’attaque cérébrale. Pour le moment, les scores ne tiennent pas du tout compte de l’aspect durée de la fibrillation auriculaire chez un patient.
La fibrillation auriculaire ne cause pas seulement des attaques cérébrales, il semble que des troubles des performances cérébrales, voire la démence y soient liées. Que sait-on à ce sujet?
La recherche à ce sujet est encore jeune. Des données relevées dans des études montrent que les personnes chez lesquelles une fibrillation auriculaire a été diagnostiquée ont des performances cognitives inférieures à celles des personnes sans fibrillation auriculaire. Attention, cela ne prouve pas un lien de cause à effet, mais un lien existe et nous voulons essayer de mieux le comprendre. C’est pourquoi, dans notre étude, nous réalisons aussi divers tests chez nos patients pour évaluer leurs performances cérébrales et nous utilisons l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour visualiser le cerveau.
Qu’avez-vous découvert jusqu’à présent?
Nos patients atteints de fibrillation auriculaire présentent à l’IRM des modifications considérables du cerveau, dont certaines sont dues à une attaque cérébrale. Mais la plupart des patients n’ont jamais eu d’accident dont ils aient eu conscience et n’ont donc jamais été sous traitement médical auparavant. L’hypothèse est qu’au moins chez certains d’entre eux, de petites attaques cérébrales se sont produites sans qu’ils les ressentent et ont laissé des traces. Ces modifications se repèrent aussi à l’aide de tests cognitifs simples. C’est ainsi que dans notre étude, les performances du cerveau sont nettement limitées chez un quart des personnes atteintes de fibrillation auriculaire. Mais à nouveau, ceci ne prouve qu’un lien et non une causalité.
Un anticoagulant pourrait-il empêcher la baisse des performances cérébrales, de même qu’il prévient l’attaque cérébrale?
Cela correspondrait à notre hypothèse et nous l’espérons naturellement. Si nous réduisons le risque d’attaque cérébrale à l’aide d’un traitement anticoagulant, nous devrions aussi pouvoir empêcher par là les petites attaques cérébrales passant inaperçues, et donc aussi la dégradation des performances cognitives. De premiers chiffres qui viennent de Scandinavie le confirment. Mais ils proviennent d’un registre étudiant le passé, il faut donc les interpréter avec prudence.
À part l’anticoagulation préventive, il y a aussi des possibilités de soigner directement la fibrillation auriculaire. Ce traitement réduit-il aussi le risque d’attaque cérébrale et de démence?
On peut soigner le trouble du rythme cardiaque proprement dit à l’aide de médicaments. Ils sont souvent suffisants au début, mais n’agissent pas bien à long terme. Au bout d’un certain temps, de nombreux patients et patientes doivent se soumettre à une intervention mini-invasive au niveau du coeur. On introduit une petite sonde à l’aine et on la pousse jusqu’au coeur afin d’y cautériser les zones d’où part la fibrillation auriculaire. La décision de ce traitement repose sur le degré de gravité des symptômes que ressent le patient et l’ampleur des limitations de ses performances physiques. Nous ne savons pas encore si ce traitement prévient aussi l’attaque cérébrale ou la dégradation des performances cérébrales.
Comment la prévention de l’attaque cérébrale chez les patients atteints de fibrillation auriculaire va-t-elle s’améliorer à l’avenir?
Le score dont nous parlions est relativement grossier. Par nos travaux de recherche, nous voulons contribuer à l’améliorer et à le rendre plus précis. À l’avenir, nous devrions pouvoir savoir plus précisément si quelqu’un va retirer un bénéfice d’un traitement préventif et quelle sera l’ampleur de ce bénéfice. Mais aussi bien sûr quel est le risque individuel d’hémorragie en raison des anticoagulants. En fonction des résultats de nos travaux de recherche ainsi que d’autres, nous allons devoir remanier nos traitements.
À condition que le diagnostic soit posé à temps.
Absolument, c’est pourquoi un autre objectif important est de poser le diagnostic le plus tôt possible. À cet effet, nous avons besoin d’un réseau. Comme mentionné précédemment, nombre de patients ne ressentent pas leurs arythmies. On pourrait par exemple imaginer d’intégrer le contrôle du rythme cardiaque au CardioTest de la Fondation Suisse de Cardiologie.
Votre projet de recherche est complexe. Est-il important pour vous de coopérer avec des chercheuses et chercheurs d’autres disciplines?
C’est extrêmement important. En tant que cardiologues, nous observons le coeur. Mais nous ne sommes pas spécialisés dans les maladies neurologiques ou dans l’imagerie du cerveau. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des radiologues et des neurologues, mais aussi avec des spécialistes des analyses de biomarqueurs et des analyses génétiques en laboratoire.
Pour finir, une question personnelle: en tant que scientifique et médecin traitant, que souhaitez-vous pour vos patients?
L’éventail de nos patientes et patients atteints de fibrillation auriculaire est large. En consultation, je vois des malades de 25 à 95 ans. Ce que je souhaite, c’est que nous puissions un jour proposer à chaque patiente et à chaque patient un traitement sur mesure. D’une part pour juguler la fibrillation auriculaire, d’autre part pour réduire le risque d’attaque cérébrale, un accident très grave pour la personne touchée ainsi que pour ses proches.
L’étude Swiss-AF-Burden
Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Fondation Suisse de Cardiologie soutient le projet Swiss-AF-Burden du professeur Michael Kühne par une somme de 500'000 francs. L’étude Swiss-AF-Burden, soutenue par le Fonds national suisse, recherche chez des patients atteints de fibrillation auriculaire si des lésions cérébrales apparaissant suite à des infarctus ou des hémorragies, y compris silencieux, pourraient être une cause de l’accélération de la dégradation des fonctions cognitives. Swiss-AF-Burden étudie en outre si une fibrillation auriculaire de longue durée entraîne plus de lésions dans le cerveau et porte atteinte aux fonctions cérébrales et cardiaques. Dans ce cadre, 2400 patients atteints de fibrillation auriculaire sont examinés chaque année pendant quatre ans dans 13 cliniques suisses.
En savoir plus
L'encouragement de la recherche par la Fondation Suisse de Cardiologie
Comment mieux soigner les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque? Quel est le rapport entre la fibrillation auriculaire et la démence vasculaire? Pourquoi le cœur des femmes bat-il autrement? Pourquoi imprimer le cœur d’un enfant avant d’opérer? La brochure sur la recherche permet de découvrir des aspects actuels de la recherche cardio-vasculaire en Suisse.
Les dons contribuent à mieux comprendre les maladies cardio-vasculaires, les dépister plus tôt et les traiter avec plus d’efficacité. Vous aussi, aidez-nous.
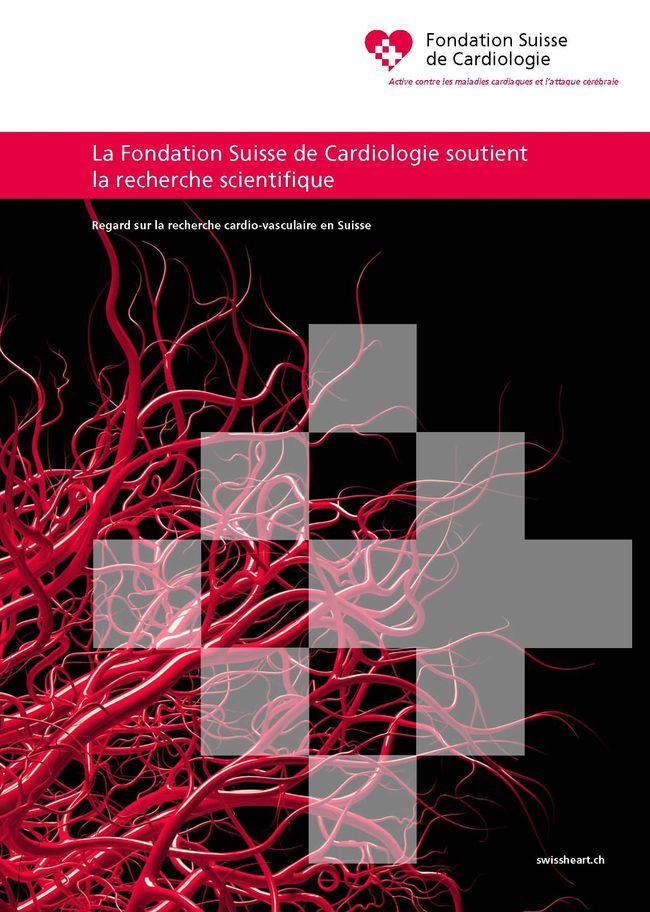
Partager le site Internet